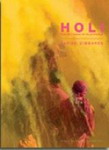
C’est à un voyage en Inde que le dernier opus du photographe Xavier Zimbardo, qui n’a de cesse de trimballer ses objectifs, son chapeau et sa curiosité tout autour du monde pour nous faire découvrir autrui à travers son regard ailé, tantôt lyrique tantôt aigu, nous convie cette fois : « Holi, Fête de l’amour et du printemps » est paru en ce mois de novembre aux Editions Images En Manœuvres.
L’Inde… Nous nous en faisons tous notre catalogue d’idées contrastées. Mais point ici de faciles envolées exotiques sur l’Inde éternelle, ni même de naturalisme sociétal sur les oripeaux de la mondialisation. Le livre est entièrement consacré à la fête de Holi, dite aussi fête des couleurs, célébrée dans toute l’Inde la veille de la pleine lune du mois de Phalgouna, en février-mars. C’est la fête de l’équinoxe de printemps, qui s’inscrit dans le cadre universel et multimillénaire des rites débridés de glorification de la fertilité, associée dans la religion hindoue au culte de Krishna. Des arcs de triomphe végétaux sont montés, d’immenses bûchers sont dressés, le combustible étant constitué par la bouse séchée des vaches sacrées ; le lendemain, c’est le charivari général : chacun asperge les autres avec de l’eau parfumée et surtout de grandes poignées de poudres de toutes les couleurs.
Elle suscite une ferveur particulière dans la région de Mathura (200 km au sud-est de Delhi), désignée comme lieu de naissance de Krishna, le sympathique joueur de flûte qui séduit les gardiennes de troupeau, divinité la plus importante du panthéon hindou. Elle dure deux à trois semaines, tournant d’un village à l’autre. Par son origine et ses manifestations, elle est exubérance et excès. A ne pas mettre un promeneur occidental dehors… C’est pourtant là que Xavier Zimbardo s’est laissé noyé par le déluge de pigments et que ses appareils photos ont souffert, eu égard à la délicatesse de leur constitution interne. Heureusement qu’à force de sillonner la planète, Xavier est apparemment fait d’une autre farine : « quelle folie et quel bonheur ce fut de pouvoir photographier ces foules en extase, hurlant de rire », des gens « dingues de chants, de danses, de couleurs, de vie, d’amour, de Dieu, de tout ce qui leur passait par la tête », raconte-t-il notamment dans le texte qui chaperonne agréablement les images. « C’est une bagarre générale, gigantesque, et en même temps une vaste rigolade. » Une gageure que d’y prendre des photos ; c’est donc en acceptant de manger de la couleur comme les autres voire de l’absorber par tous les pores, mais revêtu d’un grand drap blanc protégeant ses fragiles yeux numériques qu’il a pu fixer dans leur mémoire ces moments de jubilation bachique et d’exaltation collective qui n’ont guère d’équivalents dans nos quotidiens policés.
Les images qu’il en a ramenées constituent donc une plongée profonde dans ce stupéfiant sacre du printemps, dont le livre, en une progression théâtralisée, raconte la forte symbolique. Vêtements, voiles, turbans et visages réjouis, d’abord distinguables les uns des autres, se fardent, puis se barbouillent, puis s’entartrent en un ballet extatique. Il tombe, il bruine, il neige, il naît partout, de toutes les dimensions de l’espace, de l’eau, des fleurs, de la poudre. A partir d’un certain moment, l’air lui-même est couleur ; un brouillard polychrome de gens et de particules que Xavier Zimbardo a capturé avec autant d’empathie que de virtuosité. Evoquer la gaieté de la fête est un euphémisme : les villageois sont visiblement hilares ; on imagine, mise à part la ferveur religieuse, le plaisir enfantin que l’on doit ressentir à peinturlurer sans retenue ses parents, ses amis, ses voisins. Quelques grands-pères prévoyants aux dents fourbues mais aux moustaches vigoureuses, ont chaussé de grosses lunettes noires pour protéger leurs yeux ; çà et là, les hommes reçoivent des coups de bâtons de la part des femmes d’un autre village que le leur ; ils ont seulement le droit, ainsi veut la coutume, de se protéger avec des boucliers ; ils peuvent aussi se faire fouetter avec leurs propres chemises dont ces dames les ont prestement dépouillés. La fête n’est-elle pas toujours transgression ? On se prend à supposer que les villageoises en profitent pour châtier une domination patriarcale quotidienne… Sur d’autres clichés, des mains masculines se tendent vers des saris indifférents : les hommes supplient, les femmes passent, altières, pour une fois maîtresses du lien.
Assurément, mieux vaut ne pas être agoraphobe. La foule est d’une densité extrême, les gens échangent étroitement leur chaleur, leur exultation, leur griserie, leur humanité pour un temps au moins conjuguée. On pense à Durkheim : « quand les consciences individuelles, au lieu de rester séparées les unes des autres, entrent étroitement en rapports, agissent activement les unes sur les autres, il se dégage de leur synthèse une vie psychique d’un genre nouveau. Elle se distingue d’abord de celle que mène l’individu solitaire par sa particulière intensité. Les sentiments qui naissent et se développent au sein des groupes ont une énergie à laquelle n’atteignent pas les sentiments purement individuels. […] La vie n’y est pas seulement intense ; elle est qualitativement différente » (« Sociologie et Philosophie, Jugements de valeur et jugements de réalité », 1924) ; Holi, saint rituel de holisme ?... On songe également à la poudre d’ocre qui recouvrait les corps dans la majorité des sépultures paléolithiques, depuis les toutes premières inhumations volontaires d’il y a cent mille ans. « Holi, fête de l’amour et du printemps » est ainsi ressenti comme un saut dans le mythe, l’ancestral, l’immémorial. « Le but de cet extraordinaire festival religieux est de faire fondre les frontières entre les individus pour fusionner dans la divinité », explique d’ailleurs Xavier Zimbardo. « Les cataractes de couleurs se mêlent et se confondent en tourbillons irisés de soleil, pour masquer tous les corps, les unir en une seule apparence identique et sombre. […] Il n’y a plus d’ego, plus d’hommes ni de femmes, plus de jeunes ni de vieillards, plus de riches ni de pauvres. » Alors tout se mêle, et on se perd dans ce paysage humain qui résonne comme les tableaux de la série « Comme un seul homme » d’Alain Blondel, où premiers et seconds plans, centre et bords, tout est silhouettes humaines confondues, pressées, cousues étroitement les unes aux autres dans la trame de la toile. On effleure un drame, en se doutant que d’une page à l’autre il risque de nous sauter au visage. Les couleurs nous ravissaient, mais peu à peu on les soupçonne ; la moisissure ne prend-elle pas elle-même de séduisantes couleurs pour dégrader la matière ? « La fonction de l'art […] est de mettre au monde des interrogations, qui ne se connaissent pas encore elles-mêmes », écrit Alain Robbe-Grillet (« Pour un Nouveau Roman »).
Les photos trahissent par conséquent la violence de la proximité, de la promiscuité ultime. L’individu s’y égare. Les êtres sortent altérés de ce pressage. Les femmes se protègent la tête de leurs voiles, et en perdent leurs visages, donc leur identité ; seules leurs mains à la peau luisante et rougie en émergent, les photos obéissant ainsi au mot d’ordre du peintre Kasimir Malévitch : « le plus précieux dans la création picturale, c'est la couleur et la texture. Elles constituent l'essence picturale que le sujet a toujours tuée. » D’ailleurs, à force de la respirer avec les villageois, on étouffe, on brûle sous cette poudre envahissante qui prend une sournoise physionomie de gaz délétère. Sur la toile furieusement romantique « les derniers jours de Pompéi », du peintre russe Karl Brjullov, l’air aussi est or et rouge, mais il tue ; funeste comparaison, mais qu’y pouvons-nous ?... Les œuvres se parlent les unes aux autres, d’une sphère temporelle ou spatiale à une autre, et nous ne faisons que recueillir l’écho de leurs murmures.
La couleur flotte dans l’air sans jamais retomber, épaisse comme de la matière, composant une aura surnaturelle d’où soudain, au milieu de l’assemblée, émerge un visage souriant mais effacé, brouillé, comme surgi d’une dimension parallèle ou d’un abîme de temps. On dirait un conte fantastique : cette femme n’apparaît que sur la photo, mais en réalité il était impossible qu’elle fut là… Et de page en page, les vêtements s’alourdissent, collent aux corps en plissés somptueux, profonds et raides comme ceux des statues, les têtes se courbent et les membres s’ankylosent de fatigue, voiles et cheveux s’appesantissent ; la gaieté passée des couleurs, celle des poudres projetées comme des saris chamarrés, se fond progressivement dans un maelstrom brun de boue ; « le bon peintre est celui qui enterre une couleur chaque jour », disait Roger Bissière. Les voilà donc toutes englouties. En quel géhenne dantesque ou sur quelle Porte des Enfers ces créatures semblent-elles à présent se mêler ?...
Un nuage de poudre jaune lancé à nouveau sur les crânes fébrilement pressés les uns contre les autres, et l’on est saisi par ce qui ressemble soudain à des corps en linceuls sur lesquels de la chaux vive a été projetée pour hâter l’anéantissement des chairs. Les images de Xavier Zimbardo, en bonnes sémioticiennes, font sens pour parler directement à nos perceptions symboliques de la mort se frayant tranquillement son chemin au creux de toutes nos joies, de tous nos efforts de transcendance.
Mais sans doute ne voulait-il pas terminer son « Holi » par ce constat et par un ballet de fantômes ; c’est donc par des bras tendus et un dernier bondissement de poudre rouge que se clôt l’ouvrage : ces joyeux fêtards sont bien vivants, provisoirement repus mais reviendront l’année prochaine pour se réjouir à nouveau de concert. Espérons que les pépés à lunettes souriront encore à la vie sous leur croûte écarlate…
Sophie LICARI
Sophie LICARI